- IMAGERIE MÉDICALE
- IMAGERIE MÉDICALEDepuis dix ans, le phénomène s’affirme. En médecine, l’imagerie est désormais partout. La psychiatrie elle-même a vu scanner X ou résonance magnétique révéler des tumeurs là où l’on parlait de démence. Médecine et chirurgie ont changé, et l’on ne peut en quelques pages détailler la liste complète des innovations induites par la «nouvelle image», mais il faut souligner trois points de rupture qui ont joué ou joueront encore un rôle essentiel.C’est d’abord l’irruption de la machine dans le diagnostic. Le médecin demeure lecteur et arbitre, mais c’est l’informatique qui révèle l’anatomie. La coupe est un «extrait du corps» où l’on détectera le mal sans avoir besoin du bistouri chirurgical et où, parfois même, le radiologue saura traiter, drainer, guérir sans effraction, mais avec l’aide discrète de l’ordinateur qui guide ses gestes.Ensuite, la pléthore d’images et d’informations. Chaque «image» devient une pile de coupes qu’il faut explorer une à une jusqu’à la saturation de la vision et de la volonté d’analyse.Enfin, pour la première fois, le fait que l’accès à l’image – et parfois, pour le malade, au salut – dépende d’une autorisation administrative et, par là même, d’une volonté politique, sinon polémique.Et pourtant rien n’arrête la progression de l’imagerie moderne qui marque notre civilisation et notre médecine, qui possède une totalité significative que rien ne remplace, et que l’on classe aujourd’hui parmi les progrès majeurs du genre humain.Très longtemps limitée aux rayons X de Roentgen, l’imagerie intègre aujourd’hui l’élasticité tissulaire et les conséquences de la réflexion des ultrasons, aussi bien que les noyaux atomiques de l’imagerie de résonance magnétique. Dans cette «nouvelle imagerie», vite devenue respectable, l’informatique a contribué, là encore, à la naissance d’une nouvelle science de l’image et de son interprétation. La décomposition d’un champ en une mosaïque d’éléments quantifiés va permettre l’analyse, la reconstruction, l’élimination de l’inutile, voire l’interprétation: ainsi l’imagerie moderne est «numérique». Ce procédé quasi universel détecte les plus faibles contrastes, ceux que constituent les grands amas de cellules du foie, de la rate, du cerveau. On analysait fort mal ces «parenchymes» par opacification des vaisseaux ou des organes voisins. Les voici directement révélés (IMAGERIE MÉDICALE, Pl. I, Les images).Radiologie conventionnelleAllègre centenaire, la radiologie classique demeure une part importante de l’imagerie médicale. Les «nouvelles imageries» lui imposent cependant un déclin régulier, au moins dans les pays occidentaux.La technique demeure celle de l’ombre chinoise, projetant sur un film l’image des organes qui résulte de leur absorption différentielle des rayons. La radiologie médicale emploie des rayonnements électro-magnétiques d’énergie moyenne (de 15 à 20 keV équivalent pour la mammographie, 70 keV équivalent pour la radiographie abdominale). Le faisceau X est émis par rayonnement dû au freinage d’électrons dans une anode de tungstène; il est «modulé» par l’objet examiné, l’atténuation de l’intensité initiale I0 répondant à la formule Ix = I0e 猪x , où x est l’épaisseur du corps traversé et 猪 son coefficient d’atténuation linéaire. Ce coefficient est élevé pour l’os, moyen pour les tissus mous, faible pour la graisse. Le contraste naturel présent dans le corps humain est suffisant pour l’os ou les poumons (plus de 10 p. 100), mais très faible pour les autres tissus (moins de 2 p. 100). La radiologie conventionnelle ne peut détecter que des contrastes supérieurs à 4 p. 100 (le scanner, 0,4 p. 100): poumons ou squelette pour les contrastes naturels, vaisseaux et reins opacifiés à l’iode ou tube digestif à la bouillie barytée lorsque le contraste est insuffisant. La radiographie simple a l’inconvénient de superposer et de mêler les différents plans corporels explorés. Un mouvement inverse du tube et du plan détecteur permet de séparer la coupe qui contient le centre d’homothétie, qui constitue une tomographie. Celle-ci, floue et peu discriminante, est progressivement remplacée par les clichés au scanner X.Quel que soit le procédé radiographique, global ou sélectif, le faisceau X modulé est recueilli sur un détecteur où se crée l’image. On peut observer directement l’image de radioscopie non plus sur l’écran fluorescent (obligation de travail en salle obscure, forte irradiation, image médiocre), mais à partir d’un amplificateur de luminance et d’une chaîne télévisée. Le recueil de l’image peut être réalisé à partir de l’image vidéo (ampliphotographie, radiocinéma). Il emploie plus souvent un film couplé à des écrans renforçateurs fluorescents qui donnent de très bonnes images pour une dose d’irradiation acceptable. Certaines techniques «haute définition» utilisent des phénomènes électrostatiques (xéroradiographie) mais exigent une dose importante (Pl. I, Les images).La radiologie conventionnelle est restée un examen de premier rang dans le cas des pathologies du squelette (crâne, thorax, membres) et dans celles de la glande mammaire. L’étude des vaisseaux est pratiquée en angiographie numérique. Mais tube digestif et appareil urinaire sont de plus en plus explorés par échographie et endoscopie.Scanner XVers la fin des années 1960, un médecin neurologue américain, le Dr Oldendorf, cherchait désespérément à obtenir une image directe du cerveau par rayons X. Sur le plateau d’un phonographe, il avait disposé des objets de densité différente et démontré que l’on pouvait déterminer leur position sur ce plateau à partir d’un nombre suffisant de projections. Oldendorf touchait presque à la solution, mais il lui manquait la technologie et un appui industriel: en radiologie, il est peu de génies solitaires. En Angleterre, à la même époque, un autre neuroradiologiste, Ambrose, rencontrait à un repas d’universitaires un ingénieur et physicien, Hounsfield, et lui soumettait le même problème. On connaît la suite, et le développement du premier scanner par la firme E.M.I., qui n’avait rien à voir avec la médecine, et qui ne put, par la suite, lutter contre les géants du matériel d’imagerie. Mais cette histoire est exemplaire à plus d’un titre: ce sont deux médecins qui eurent l’idée initiale de la recherche (beaucoup pensent d’ailleurs qu’Oldendorf a été injustement écarté des honneurs). Celui des deux qui a pu rencontrer l’ingénieur capable de répondre à sa demande a gagné la course – mais pas le prix Nobel. Comme dans presque toutes les inventions médicales, un contact interdisciplinaire a été le révélateur. Il s’est heureusement associé au génie d’un Hounsfield, mais ce dernier n’a pu développer l’invention imprévue que dans la liberté d’un laboratoire où l’on acceptait des recherches non planifiées.Par une schématisation malheureuse, cet appareil de «computerized tomography» (C.T.) est devenu en France le «scanner». Le nom savant de tomodensitomètre n’est guère employé dans le public. Les tentatives académiques pour imposer scanographe ou scanneur n’ont guère réussi hors des ministères. Comme il existe beaucoup de «scanners», l’usage est aujourd’hui d’ajouter le X (de rayons X), qui marque sa particularité.Le principe du scanner X tient en deux temps: analyse multi-angulaire, puis reconstruction mathématique.À l’instant t , correspondant à une incidence angulaire , les récepteurs recueillent un «profil d’intensité»:
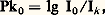 où I0 est l’intensité incidente et Ik les valeurs d’intensité de tous les rayons parvenant aux détecteurs. L’angle change, un nouveau profil est acquis et enregistré et ainsi de suite, de degré en degré, en pivotant autour du sujet examiné. À la fin de la rotation, l’ordinateur recalcule l’intensité de chacun des éléments (picture-cells ou pixels) de la coupe, et reconstitue l’image anatomique sur une «matrice» de 256 憐 256 ou 512 憐 512 pixels.La base de l’image du scanner X est le calcul du coefficient d’atténuation des rayons X dans chaque «voxel» (volume élémentaire correspondant dans la coupe au pixel de l’image) et l’affectation d’un niveau de gris à la valeur mesurée. Les performances varient avec les appareillages, mais un bon scanner X peut, en moins de deux secondes, donner des images dont le pixel est inférieur au millimètre et le contraste minimal de l’ordre de 0,4 p. 100.Le scanner X est un appareil à diffusion restreinte par des contraintes administratives (liste des «équipements lourds»). Longtemps confiné aux examens cranio-cérébraux, le scanner X a envahi tous les secteurs de la médecine (fig. 1), y compris la tomographie analogique qui tend à disparaître.Ses indications médicales et ses résultats demeurent très larges, mais sont aujourd’hui concurrencés par l’imagerie par résonance magnétique nucléaire. Leurs caractéristiques sont comparativement les suivantes:– scanner rayons X: radiations ionisantes, mise en rotation de l’appareillage, orientation transversale des plans de coupe, résolution spatiale fixée par les détecteurs, acquisition en quelques secondes;– I.R.M.: champs électromagnétiques, appareillage sans éléments mobiles, orientation quelconque des plans de coupe par sélection électronique, résolution spatiale fixée par le temps de mesure et acquisition en quelques minutes.Le premier (scanner X) donne une carte anatomique avec effet de masque osseux; le second (I.R.M.), une carte anatomique et chimique avec transparence du squelette.En 1989, les indications neurologiques de première ligne du scanner X, pour lesquelles il est égal ou meilleur que l’I.R.M., étaient les suivantes: syndrome tumoral, avec ou sans hypertension intracrânienne, localisé à la convexité; traumatologie aiguë; suspicion de méningiomes ou de tumeurs calcifiées; lésions vasculaires; lésions maxillo-faciales.On notait par ailleurs comme indications de première ligne pour le corps entier, à la même date: pathologie non tumorale du squelette; pathologie pulmonaire; pathologie médiastinale (à l’exception du thymus); tumeurs, abcès, kystes du foie; pathologie pancréatique; pathologie surrénalienne; recherche de ganglions lymphomateux ou métastatiques.Scintigraphie ou gammagraphieAprès injection dans l’organisme d’un traceur radioactif émetteur 塚 ou X, un détecteur (gammacaméra) permet d’obtenir une image de l’organe sur lequel le traceur s’est fixé. L’image scintigraphique a une résolution spatiale médiocre (de 2 à 5 mm), mais apporte de précieux renseignements fonctionnels, en particulier lorsqu’on réalise des successions d’images qui renseignent sur la cinétique du traceur (scintigraphie dynamique). Les traceurs actuellement utilisés sont le technétium (99 mTc), combiné à diverses molécules qui orientent sa fixation (gluconates, pyrophosphates, colloïdes, globules rouges fragilisés, etc.). L’iode 131, le xénon 133, le gallium 67 ont des indications particulières (cf. médecine NUCLÉAIRE).Les applications de la scintigraphie demeurent nombreuses et ses principales indications sont, pour le cerveau: tumeurs, débit sanguin, troubles du transit du liquide céphalo-rachidien; pour le squelette: métastases, infections, certaines tumeurs; pour la thyroïde: nodules et kystes; pour les poumons: perfusion, ventilation; pour les surrénales: tumeurs et hyperplasies; pour le foie et la rate: tumeurs, hématomes; pour les reins: fonction rénale.Échographie et Doppler: le stéthoscope de demain?Sans danger, indolore, peu coûteux, l’emploi des ultrasons a connu une expansion fantastique depuis les premiers essais des années 1960. Aucune femme enceinte n’y échappe. L’échographie donne d’excellentes images du foie, de la rate, des reins, de la thyroïde, de la prostate et des organes génitaux. Pourtant, le tube digestif, le poumon et l’os ne peuvent être explorés, en raison surtout des lois physiques de formation auxquelles obéit ce type d’image. Les ondes ultrasonores ont une fréquence élevée: de 3 à 10 MHz en échographie médicale (le son est limité à 25-30 kHz). Elles se propagent aisément dans les liquides ou dans les demi-solides constitués par les parenchymes. Toute discontinuité tissulaire provoque un écho partiel que l’on peut localiser dans l’organe exploré par son temps de retour à la «sonde» émettrice et réceptrice. Le principe est le même que celui de l’évaluation de distance d’une montagne «échogène» par mesure du temps de retour de l’écho (la vitesse du son dans l’air, comme dans les tissus, est connue).Si l’on représente alors chaque écho par un point sur la ligne correspondant à la direction de l’émission, il suffit d’émettre selon des directions multiples pour reconstituer les contours et la structure de l’organe exploré. Les échographes actuels donnent en temps réel des images obtenues par sonde rotative (lignes divergentes) ou à partir de barrettes faites de cristaux multiples juxtaposés. On voit aujourd’hui les organes, leurs mouvements, leurs battements au moyen d’appareils très faciles à manipuler puisqu’il suffit de poser sur le ventre, le cou ou les membres une plaquette ou un petit cylindre que l’on peut déplacer et orienter à sa guise. La définition de l’image augmente avec la fréquence, mais l’atténuation du faisceau est très rapide pour les fréquences supérieures à 5 MHz.La limite de ce merveilleux outil apparaît lorsque le faisceau d’ultrasons se réfléchit en totalité sur le squelette ou les gaz (air pulmonaire, gaz intestinaux), ce qui explique qu’il soit impossible d’explorer le crâne de l’adulte ou les poumons. L’autre limite est liée à l’interprétation des coupes obliques ou de secteurs complexes, où une parfaite connaissance de l’anatomie est indispensable (fig. 2).On définit classiquement deux modes d’échographie: le mode A, qui représente les pics des échos sur la ligne d’émission et donne la distance des structures, et le mode B, qui transpose ces pics en points d’intensité lumineuse proportionnelle et utilise de multiples lignes pour reconstruire directement la morphologie. L’échographie temps-mouvement (T.M.) visualise les variations des échos de structures cardiaques (valves, parois) au cours du cycle. D’autres modes ont été proposés (holographie ultrasonore, images de transmission), mais le mode B est le plus employé, et ses applications médicales sont très étendues.Il existait en 1985 quatre mille échographes en France, employés surtout par les obstétriciens (50 p. 100) et les radiologues (30 p. 100). Cardiologues, gastro-entérologues, médecins généralistes et spécialistes divers se partagent les 20 p. 100 restants. Une forte tendance se développe en faveur d’un accès de tous les médecins à cette technologie: échographes per-opératoires des chirurgiens, échographes endoscopiques des gastro-entérologues, échographes cardio-vasculaires de plus en plus perfectionnés. Les spécialistes de l’imagerie sont aujourd’hui divisés sur cette prolifération. Deux attitudes se distinguent: les uns souhaitent restreindre à des spécialistes très entraînés une technique d’interprétation souvent délicate et qui nécessite un bon apprentissage; les autres voient dans ces appareils d’emploi simple un «stéthoscope ultrasonore» que tout médecin devrait employer au cours d’un examen médical, quitte à s’adresser à un spécialiste de l’imagerie si une difficulté d’interprétation survient. Attitude logique et moderne, mais qui impliquerait un non-remboursement de ces actes de consultation et l’inclusion dans les études médicales de l’apprentissage indispensable.Voici quelles sont les principales applications médicales de l’échographie B:– crâne-cerveau: uniquement chez l’enfant, à travers les fontanelles; le faisceau ne traverse pas le crâne chez l’adulte;– cou: thyroïde, parathyroïde, vaisseaux du cou;– thorax: surtout le cœur, l’air pulmonaire masquant les autres structures;– pelvis: utérus, ovaires, testicules, prostate, vessie; surveillance obstétricale;– membres: tendons, hématomes, vaisseaux;– sein: recherche de kystes ou de certaines tumeurs.L’échographie Doppler apporte un complément très efficace à l’imagerie en évaluant les flux vasculaires. Chacun sait que le son émis par un objet en mouvement (sifflement d’un train par exemple) devient de plus en plus aigu lorsqu’il se rapproche et de plus en plus grave lorsqu’il s’éloigne. Le changement de fréquence des ultrasons réfléchis par des globules sanguins en mouvement permet d’évaluer leur vitesse. Des progrès très spectaculaires permettent aujourd’hui de superposer à l’image échographique d’un vaisseau une représentation colorée des vitesses qui autorise la détection directe sur l’image des sténoses (rétrécissements) ou des thromboses (occlusions vasculaires).Les risques de l’exploration ultrasonore ont été très étudiés, en raison de la diffusion de la méthode. Des faisceaux d’ultrasons de haute puissance (plus de 1 W/cm2) entraînent une altération permanente des tissus traversés. Les puissances moyennes utilisées en diagnostic médical sont de 20 milliwatts, et ce sans aucune conséquence tissulaire.Imagerie par résonance magnétique (I.R.M.)Immédiatement après la découverte de Bloch et Purcell, la résonance magnétique nucléaire (R.M.N.) devint un instrument privilégié en chimie organique. Elle donnait des renseignements inégalables sur la structure des molécules, les liaisons chimiques ou le taux de réaction des substances examinées. Un an à peine après la découverte, Bloch tenta une application biologique: en 1948, il introduisit un doigt dans la bobine de son spectromètre et reçut un signal R.M.N. Il restait à coder le signal dans l’espace pour en faire une image. Un Français, Gabillard, faillit trouver la solution en 1950, mais abandonna son approche. C’est en fait en 1969 que l’idée vint à un professeur de la faculté de médecine de New York, Damadian, de tenter de voir le cancer par imagerie R.M.N. Le premier, il comprit que la localisation spatiale était le concept crucial et il proposa une solution de balayage peu efficace mais possible dans une série d’articles publiés en 1971 par la revue Science . Dès cette date, avec une étonnante prescience, Damadian écrivait: «De tels détecteurs constitueront un équipement standard dans les hôpitaux et les cliniques.» Ce concept révolutionnaire, proposé par un intrus, un médecin, fut rejeté avec violence par le milieu de la chimie physique. On montre encore dans certains laboratoires la lettre d’un «expert» du C.N.R.S. qui affirmait en 1972 l’impossibilité de ce type d’imagerie. On relit avec étonnement les déclarations de savants professeurs jurant que la R.M.N. parviendrait tout juste à montrer les pépins d’un grain de raisin. Cependant, à travers d’incroyables difficultés, Damadian entreprenait la réalisation d’un aimant supraconducteur qui devait aboutir en 1977 aux premières images du thorax humain. Certes, dès 1976, des physiciens à l’esprit plus ouvert avaient obtenu des images de petits objets. Lauterbur avait défini la méthode de localisation par «gradients» de champ. Mansfield mit au point en Angleterre un intéressant procédé d’excitation sélective. Il n’en reste pas moins que l’idée initiale et la première application pratique sont venues de Damadian, médecin devenu physicien par force.Les principes de l’imagerie par résonance magnétique sont fondés sur les propriétés de certains noyaux atomiques de spin non nul que l’on peut assimiler à de petits aimants (dipôles). L’hydrogène H, le sodium 23 Na, le phosphore 31P sont, parmi beaucoup d’autres, des atomes utilisables. Depuis 1987, l’I.R.M. est surtout basée sur le proton, noyau d’hydrogène très abondant dans le corps humain.La création du «signal R.M.N.» se fait en deux temps. Le corps examiné est d’abord placé dans un puissant champ magnétique (de 5 000 à 20 000 gauss) qui aligne les protons dans l’axe du champ. Un deuxième champ magnétique oscillant à une certaine fréquence perturbe l’équilibre et déclenche une bascule des axes de rotation des noyaux. Lorsque l’excitation cesse, le système ainsi perturbé revient à l’état initial et réémet un signal (restitution d’énergie) pendant le temps du retour à l’équilibre (temps de relaxation). Des codages spatiaux utilisant des gradients de champ magnétique permettent de mesurer le signal point par point et de reconstruire l’image d’une coupe.L’imagerie par résonance magnétique dépend de paramètres multiples, ce qui fait sa valeur pour tenter de «caractériser» les tissus examinés: la densité de protons, les «temps de relaxation» qui dépendent de la structure chimique moléculaire, les flux sanguins ou capillaires et d’autres facteurs interviennent. L’examen apparaît sans danger, sauf pour les porteurs de pacemaker, de prothèses métalliques ou de clips ou les malades ayant des inclusions métalliques (éclats), tous ces éléments risquant d’être modifiés ou déplacés par le champ magnétique.Les résultats de l’I.R.M. sont remarquables (fig. 3). Le contraste des tissus dépasse celui des meilleurs scanners X, et tous les plans de coupe sont possibles (le scanner n’autorise que des coupes horizontales, dites axiales ou transversales). Le tableau 1 résume les principales indications possibles. Les limites de la méthode apparaissent dans l’étude des organes mobiles (thorax ou abdomen), car le temps d’acquisition d’une image est encore de quelques minutes. La méthode progresse vite, et devrait, d’ici à quelques années, remplacer un grand nombre des indications du scanner X et de l’échographie. Les meilleures applications actuelles demeurent cependant le cerveau et la moelle épinière, d’une part, les os et les articulations, d’autre part, régions qu’il est facile d’immobiliser complètement.Les contraintes sont surtout financières (une dizaine de millions de francs à l’achat, avec un prix de revient de 3 000 francs par examen), mais aussi techniques: appareils lourds (de 10 à 90 t) et champ magnétique étendu à plusieurs mètres de l’appareil, ce qui perturbe les appareils électroniques et les enregistreurs magnétiques.Radiologie interventionnelleL’explosion récente de l’imagerie a transformé la médecine. Elle fait aussi évoluer les radiologistes vers des comportements plus actifs, dans leurs diagnostics et leurs thérapeutiques.La radiologie interventionnelle diagnostique ponctionne abcès ou tumeurs sous guidage par ultrasons ou scanner X. Très souvent, il n’est plus nécessaire d’avoir recours à la laparotomie exploratrice (ouverture de l’abdomen) pour rechercher la lésion. Les aiguilles inframillimétriques employées sont inoffensives.La radiologie interventionnelle thérapeutique a trois orientations principales: l’embolisation des malformations vasculaires ou des pédicules tumoraux, la dilatation des vaisseaux ou des canaux rétrécis, et l’aspiration-drainage des abcès, hématomes ou épanchements de l’abdomen et du thorax.Tous ces actes sont peu ou ne sont pas traumatisants; ils ne nécessitent qu’une très courte hospitalisation et évitent au malade une chirurgie souvent complexe. Mieux vaut un scanner qu’une cicatrice (fig. 4).Lecture et interprétation: le radiodiagnosticRien ne s’oppose en théorie à ce qu’un jour l’œil du robot soit capable de lire et d’interpréter en expert, parfois, l’image médicale. Le savoir est de plus en plus «informatisé» et divisé, mais il est peu probable que la synthèse des maux dont souffre un homme puisse être faite par la machine. Le maître mot de l’imagerie demeure en effet son «interprétation», autour de laquelle gravitent les connaissances du «lecteur» aussi bien que les hypothèses particulières issues du patient examiné (Pl. II, L’interprétation).La réflexion clinique relie les symptômes, et doit compter avec une problématique de l’intégral, quitte à gommer abusivement parfois les particularismes. À l’objectivité excessive d’une lecture automatique risque ainsi de s’opposer, dans certains cas, une interprétation orientée.L’imagerie nouvelle aggrave encore la difficulté: depuis une dizaine d’années, les différences d’opacité (du noir au transparent) sont codées sur 500 à 4 000 niveaux de «gris» (de 9 à 12 bits) alors que l’œil ne peut observer avec un bon contraste que de 60 à 100 niveaux (de 6 à 7 bits). On ne peut plus parler d’une image de scanner ou d’I.R.M., mais d’une pile de structures qu’il faut explorer l’une après l’autre au moyen d’une fenêtre acceptable. On parle constamment en scanographie de «fenêtre os», de «fenêtre pulmonaire», etc., correspondant chacune à un réglage différent de la console de visualisation (fig. 5).Prenons un exemple simple: un homme de cinquante ans a mal au dos. La radiographie conventionnelle réalisée sur un film de dynamique limitée (100 niveaux de gris) ne montre que le squelette mais peut être «lue» devant une quelconque source lumineuse: négatoscope médical, lampe, voire lumière du jour. Le scanner de la vertèbre douloureuse doit être lu sur la console avec plusieurs fenêtrages. Un examen en fenêtre «tissus mous» peut montrer l’absence de hernie discale et effacer l’image d’une métastase cancéreuse qu’aurait révélée un fenêtrage différent.Ainsi, à la pléthore des images, s’ajoute leur extrême complexité. La nouvelle imagerie doit renoncer aujourd’hui à restituer le contenu réel d’un examen. La complexité dynamique de l’image ne serait compatible qu’avec un disque magnétique ou optique que chaque médecin pourrait consulter sur sa console. Mais que de temps perdu. L’«extrait interprété», sur un film ou un papier, suffit, si l’interprète est bon. Mais se trouve remis en question, dans cette perspective, le postulat qui veut que soit disponible l’intégralité des informations obtenues.Problèmes d’utilisationAccepter l’imagerie moderneL’imagerie médicale fait peur lorsqu’on la connaît mal. Elle emploie des appareils onéreux, mais sa part dans les dépenses de santé augmente moins vite que le coût du personnel paramédical: les dépenses actuellement liées à l’imagerie en France ne représentent que 5 p. 100 du total des dépenses de santé. Surtout, c’est à l’intérieur du budget de l’imagerie que de nouveaux équilibres apparaissent. Contrairement à ce que pensent des augures mal informés (fig. 6), l’addition des examens n’a lieu que pendant une courte période d’évaluation comparative. Scanner X et échographie ont pratiquement éliminé le recours à l’angiographie, plus dangereuse: entre 1975 et 1985, les examens vasculaires ont chuté de 36 p. 100 en R.F.A. et de 55 p. 100 en France. L’endoscopie a littéralement tué l’exploration digestive à base de bouillie barytée, au point qu’il est difficile dans certains hôpitaux d’en apprendre la technique aux étudiants. Scanner et I.R.M. ont considérablement diminué la myélographie, opacification pénible des enveloppes de la moelle; l’encéphalographie gazeuse (pour voir les ventricules cérébraux) et l’arthrographie du genou sont menacées. D’innombrables études de rapports coûts/bénéfices ont prouvé quel était l’intérêt économique d’un emploi judicieux de la «nouvelle imagerie». Prenons deux exemples bien connus aujourd’hui: de 1975 à 1985, le coût du diagnostic et du traitement d’un ictère (jaunisse) a diminué de 77 p. 100. Durant la même période, le coût du diagnostic d’une sciatique grave a diminué de 60 p. 100. Plus encore, l’imagerie moderne a largement contribué à la réduction de la durée moyenne de séjour, passée de près de 20 jours à 5 grâce aux nouveaux moyens de diagnostic. Personne n’accepterait le retour à cette époque où le diagnostic d’une lésion abdominale était fait par ouverture du ventre, ce que l’on appelait la laparotomie exploratrice, intervention lourde et non dépourvue de complications.Aux États-Unis, l’angioplastie (dilatation des artères) revient à 4 700 dollars, contre 15 000 pour le classique pontage. En R.F.A., la diffusion de la lithotriptie (destruction des calculs), guidée par l’indispensable imagerie, permet d’épargner 140 millions de deutsche Mark par an (près de 500 millions de francs) et rembourse très largement l’investissement. On pourrait multiplier à l’infini ces exemples.Malgré de tels avantages, pour quelles raisons subsiste-t-il un courant de rejet ou de refus de l’imagerie dans le corps médical? Certes, la radiologie semble opulente et elle consomme une bonne part des chiches crédits d’équipement: la simple maintenance de certains scanner X coûte plus d’un million de francs par an. Mais ces analyses sont démenties par les économies réalisées et par la mutation médicale qu’induisent ces appareils. Faut-il alors voir là une crainte plus ou moins consciente d’une évolution faustienne où la machine déshumaniserait la médecine? C’est possible, mais très irrationnel. Tout appareil – fibroscope, scanner ou caméra scintigraphique – est une extension de la vue; il permet de voir l’intérieur du patient. Pourquoi le fait de mieux percevoir la lésion cherchée aboutirait-il à une médecine inhumaine? Que l’on palpe un abdomen ou que l’on regarde une coupe, la qualité de l’acte médical ne peut changer et elle sera toujours le reflet de la qualité du médecin. Simplement, on n’examine plus un pancréas ou un rein en 1987 comme en 1970 (fig. 6).Il reste toutefois un frein éducatif. Les progrès ont été si rapides que beaucoup de médecins sont restés sur la rive. La prescription des nouveaux examens doit suivre des règles rigoureuses qu’il faut apprendre. Or l’enseignement de l’imagerie est absent des programmes de la plupart des facultés: on découvre encore dans les «questions d’internat» des listes absurdes d’«examens complémentaires» que l’on retrouvera sur les fiches de prescription établies par les jeunes médecins. Un effort pédagogique important demeure donc nécessaire.Devenue indispensable, l’imagerie médicale fait peur lorsqu’on la connaît mal. Elle accroît pourtant la probabilité du résultat de l’acte médical et réduit la durée de l’hospitalisation. Elle est un des grands progrès qui ont permis la mutation de la médecine actuelle.Difficultés socio-économiquesEn 1988, 4 358 radiologistes utilisent en France 25 000 tables d’examen, près de 400 scanners X, 53 I.R.M. et un nombre inconnu d’échographes. Deux actes radiologiques par habitant (100 millions) sont réalisés chaque année, et représentent une valeur de plus de 10 milliards de francs. La croissance rapide (9 p. 100 par an) observée jusqu’en 1980 s’est ralentie pour les radiographies conventionnelles, mais demeure forte pour l’échographie et le scanner X. Dans son ensemble, l’activité radiologique française reste dans la moyenne des pays industrialisés.De nombreux non-radiologistes réalisent des examens d’imagerie (cardiologues, gastro-entérologues, pneumologues). Les radiologistes, qui gardent 70 p. 100 de l’activité en ce domaine, sont tentés par une surspécialisation, probablement inévitable. Il existe ainsi des neuro-radiologues et des radio-pédiatres, mais aussi des échographistes, des scanographistes, ou même des spécialistes de la radiologie interventionnelle touchant à la chirurgie. Il n’est pas certain que l’unité de la discipline survive à ces tendances centrifuges.La construction du matériel biomédical d’imagerie est devenue une entreprise coûteuse, tributaire aussi de très importantes dépenses de recherche. En 1988, le marché mondial représentait 6 000 millions de dollars (États-Unis, 50 p. 100; Europe, 24 p. 100). Le marché français ne dépasse pas 4,5 p. 100 de cet ensemble, soit 1 900 millions de francs environ. Il est cependant en évolution rapide: certes, la radiologie conventionnelle y représente encore 50 p. 100, mais elle stagne. Le scanner représente, en francs, 13 p. 100 des achats (croissance: 5 p. 100 par an), l’échographie 20 p. 100 (croissance: 16 p. 100 par an) et l’I.R.M. 15 p. 100 (avec une croissance de 20 p. 100 par an). Les alliances industrielles de 1987 ne laissent en place que quatre groupes géants: General Electric + C.G.R. (25 p. 100 du marché mondial), Philips (15 p. 100), Siemens (19 p. 100), Toshiba (9 p. 100). Une pléiade de plus petites industries ou de fabricants d’accessoires complète ce tableau.Réglementation de l’imagerie médicaleTous les pays, même les plus avancés, éprouvent des difficultés d’acquisition et de développement vis-à-vis des nouvelles technologies. Après une phase de réglementation assez stricte, l’implantation de scanners X et d’I.R.M. est pratiquement libre aux États-Unis, certains examens I.R.M. n’étant cependant pas remboursés par les assurances. Le frein est puissant en Angleterre, mais contrôlé en grande partie par le corps médical. Le pouvoir administratif est moins strict en France, mais les avis médicaux ne sont pas majoritaires; d’où un risque d’arbitraire et une trop grande soumission aux pressions politiques.Scanners X, I.R.M. et caméras de scintigraphie sont inscrits sur la liste des «équipements lourds» prévus par l’article 46 de la loi du 31 décembre 1970. Les «indices de besoins» sont liés à la «carte sanitaire» et doivent assurer une répartition harmonieuse des appareils. Pour le scanner X, l’indice est passé de 1 pour 1 000 000 d’habitants en 1976 à 1 pour 140 000 à 250 000 habitants en 1987. L’indice 1987 de l’I.R.M. est de 1 pour 600 000 à 1 600 000 habitants, celui des caméras de scintillation de 1 pour 150 000. L’effet de freinage a joué, en particulier pour le scanner X, mais la pression médicale s’est faite si forte dans les années 1980 que la position de l’administration est vite devenue intenable. C’est, en effet, aux possibilités de diagnostic rapide et non invasif du scanner X que sont dues, en grande partie, la réduction des durées d’hospitalisation observée de 1975 à 1985 et la modification du cours et du traitement de nombreuses affections.En 1989, l’examen au scanner est devenu courant, applicable «de la tête aux pieds» à de très nombreuses pathologies, un examen radiologique comme les autres, avec un coût d’investissement en baisse; il n’existe plus de raisons pour réglementer son emploi. Ce n’est plus tant le scanner que l’administration cherche à contrôler, mais la radiologie. À cette pression aveugle d’une contrainte quantitative (rationnement de l’offre), il convient de substituer au plus vite le contrôle qualitatif lié à la logique médicale (rationalisation de la prescription) qui peut, lui, s’appuyer sur un consensus scientifiquement établi.Risque et radioprotectionLe risque de radiations en matière d’imagerie médicale existe. On l’exagère souvent, on le néglige parfois, mais nul ne peut le nier. Les accidents aigus sont devenus rarissimes avec les appareils modernes. Les risques réels sont statistiques, proportionnels à la dose et peuvent être classés selon deux groupes: les risques somatiques, qui concernent tous les organes, mais particulièrement les organes «sensibles» (tabl. 2); les risques génétiques, qui sont d’évaluation difficile. Si l’on admet que la dose de 30 rads (0,3 Gy) sur les gonades double la fréquence spontanée des mutations, le taux d’anomalies génétiques s’est néanmoins révélé très faible chez les descendants des survivants des bombardements atomiques. La plupart des mutations graves sont létales et n’apparaissent pas dans la population. Pour un fœtus ou un embryon, on admet que la dose critique est située entre 5 et 10 rads.L’irradiation des patients est un sujet de préoccupation important depuis quelques années en raison de la croissance du radiodiagnostic, dont l’activité double tous les dix ans. L’irradiation médicale est devenue une des principales sources de rayonnements ionisants atteignant les gonades, dont le tableau 2 donne les valeurs moyennes.La dosimétrie de la radiographie pulmonaire offre des difficultés particulières en raison de la fréquence de cet examen, très largement exécuté lors des examens systématiques. Le meilleur moyen d’examiner le thorax est le cliché simple de face, grand format, qui délivre une dose modérée (de 50 à 100 mrem) encore abaissée par l’emploi d’écrans haute sensibilité (de 10 à 20 mrem). Ces valeurs s’opposent aux 800 millirems nécessaires en radiophotographie 10 憐 10 cm (camions de dépistage) et surtout aux 3 000 millirems d’une minute de radioscopie pulmonaire «conventionnelle». Lorsqu’il est encore nécessaire (travailleurs immigrés, mineurs, personnel hospitalier, fumeurs), l’examen systématique devrait être pratiqué en «grand format et écrans sensibles». De la même manière, une autre solution que l’emploi des rayons X devra être recherchée pour le dépistage de la luxation de la hanche, source d’irradiation importante des gonades et de la moelle osseuse chez le très jeune enfant. Enfin, la sensibilité du fœtus à l’irradiation doit faire proscrire chez la femme enceinte tout examen inutile, et choisir pour les radiographies indispensables les techniques les moins irradiantes.La radioprotection pratique est réglementée par l’arrêté d’avril 1962, le décret du 15 mars 1967, l’arrêté du 23 mai 1977 (qui concerne essentiellement la protection de la femme enceinte) et celui du 10 octobre 1977, qui introduit la notion de radioprotection du patient.Il convient, en conclusion, de souligner le fait que le bilan bénéfice/risque des examens radiologiques est largement positif. La plupart des examens prescrits et des clichés réalisés sont indispensables. La radiologie influence l’orientation diagnostique du clinicien dans la majorité des cas et on ne saurait parler d’abus des rayons X. Le développement de l’activité radiologique impose pourtant une certaine vigilance, la révision de certains protocoles «de routine», une réflexion sur la hiérarchie des examens d’imagerie et l’orientation des premières séquences vers l’emploi des ultrasons. Enfin, l’éducation technique de tous les utilisateurs de rayons X, y compris des non-radiologistes, est devenue une nécessité.Quel avenir?On ne peut encore affirmer que les techniques d’imagerie en coupe employant les rayons X ou la R.M.N. donnent des informations équivalentes à la coupe histologique. Le problème de la «caractérisation tissulaire» reste posé. Sa solution est la réponse que tous attendent à la question: cancer ou non?Mais la science ne peut résoudre des problèmes que si les acteurs du combat médical posent les bonnes questions. Dans l’ensemble, les systèmes d’imagerie proposés par les constructeurs ou les physiciens sans besoin médical exprimé sont des échecs. Que l’on songe par exemple à la thermographie dérivée des matériels militaires, et d’intérêt médical quasi nul, ou à certaines applications des ultrasons (balayage automatique en cuve) qu’un constructeur a tenté d’imposer sans succès.Hommage aux audacieux médecins qui surent, comme Ambrose ou Damadian, poser le vrai problème. Hommage aux esprits ouverts des physiciens qui, tels Hounsfield ou Lauterbur, parvinrent à comprendre ce que voulaient les médecins, en dépit des difficultés évidentes de la communication entre scientifiques de formation différente.En présence d’un besoin technologique médical, il est probable que l’ingénieur détient la solution. Encore faut-il que se rencontrent les protagonistes. La force de l’Université anglaise est de savoir organiser ces déjeuners informels, ces bavardages autour du thé dont sont sorties la plupart des innovations. On ne peut pas dire que les constructeurs, obsédés par le profit immédiat, aient saisi l’occasion. Ni pour les ultrasons, ni pour le scanner, ni pour l’I.R.M., on ne les vit au premier rang. Leur succès final est celui du commerce, du rouleau compresseur qui lamine la P.M.E. innovatrice en s’appuyant sur l’indispensable réseau commercial.Reste-t-il encore quelque espoir de voir des innovations en imagerie? Certainement oui, si nous savons organiser et stimuler les contacts entre physiciens et médecins, si nous développons les laboratoires universitaires d’imagerie médicale, si les médecins apprennent un peu de physique, et les physiciens des éléments de médecine. Le cloisonnement français devrait prendre exemple sur la souplesse anglaise.Dans ce cadre élargi, la confiance entre médecins et ingénieurs doit être un élément essentiel, même s’il lui faut parfois les béquilles que sont contrats et conventions. Le physicien doit accepter d’associer à sa découverte le médecin donneur d’idées. Le médecin doit se former à la rigueur méthodologique qui lui permettra d’appliquer à la «recherche clinique» nouveaux produits ou appareils expérimentaux. C’est grâce à une véritable «task-force» constituée autour du site médico-industriel de Buc que l’imagerie I.R.M. française a été mise au point entre 1983 et 1985, dans un temps record.Peut-on, pour conclure, suggérer quelques directions? Les imageries micro-ondes paraissent dans l’impasse. L’exploitation complète de l’interaction entre ultrasons et tissus progresse lentement, les cartographies électriques, cérébrales ou cardiaques, sont perfectibles, mais l’imagerie de marqueurs immunologiques à fixation spécifique ou de traceurs nouveaux peut apporter la réponse tant attendue à la caractérisation d’un tissu. La R.M.N. est-elle la «dernière fenêtre» de l’imagerie? Certains le pensent. Seul l’avenir pourra en décider. Quiconque prédit l’avenir technologique est assuré de se tromper. Cet avenir dépend très directement de la créativité et de l’innovation. Il ne peut que surprendre.
où I0 est l’intensité incidente et Ik les valeurs d’intensité de tous les rayons parvenant aux détecteurs. L’angle change, un nouveau profil est acquis et enregistré et ainsi de suite, de degré en degré, en pivotant autour du sujet examiné. À la fin de la rotation, l’ordinateur recalcule l’intensité de chacun des éléments (picture-cells ou pixels) de la coupe, et reconstitue l’image anatomique sur une «matrice» de 256 憐 256 ou 512 憐 512 pixels.La base de l’image du scanner X est le calcul du coefficient d’atténuation des rayons X dans chaque «voxel» (volume élémentaire correspondant dans la coupe au pixel de l’image) et l’affectation d’un niveau de gris à la valeur mesurée. Les performances varient avec les appareillages, mais un bon scanner X peut, en moins de deux secondes, donner des images dont le pixel est inférieur au millimètre et le contraste minimal de l’ordre de 0,4 p. 100.Le scanner X est un appareil à diffusion restreinte par des contraintes administratives (liste des «équipements lourds»). Longtemps confiné aux examens cranio-cérébraux, le scanner X a envahi tous les secteurs de la médecine (fig. 1), y compris la tomographie analogique qui tend à disparaître.Ses indications médicales et ses résultats demeurent très larges, mais sont aujourd’hui concurrencés par l’imagerie par résonance magnétique nucléaire. Leurs caractéristiques sont comparativement les suivantes:– scanner rayons X: radiations ionisantes, mise en rotation de l’appareillage, orientation transversale des plans de coupe, résolution spatiale fixée par les détecteurs, acquisition en quelques secondes;– I.R.M.: champs électromagnétiques, appareillage sans éléments mobiles, orientation quelconque des plans de coupe par sélection électronique, résolution spatiale fixée par le temps de mesure et acquisition en quelques minutes.Le premier (scanner X) donne une carte anatomique avec effet de masque osseux; le second (I.R.M.), une carte anatomique et chimique avec transparence du squelette.En 1989, les indications neurologiques de première ligne du scanner X, pour lesquelles il est égal ou meilleur que l’I.R.M., étaient les suivantes: syndrome tumoral, avec ou sans hypertension intracrânienne, localisé à la convexité; traumatologie aiguë; suspicion de méningiomes ou de tumeurs calcifiées; lésions vasculaires; lésions maxillo-faciales.On notait par ailleurs comme indications de première ligne pour le corps entier, à la même date: pathologie non tumorale du squelette; pathologie pulmonaire; pathologie médiastinale (à l’exception du thymus); tumeurs, abcès, kystes du foie; pathologie pancréatique; pathologie surrénalienne; recherche de ganglions lymphomateux ou métastatiques.Scintigraphie ou gammagraphieAprès injection dans l’organisme d’un traceur radioactif émetteur 塚 ou X, un détecteur (gammacaméra) permet d’obtenir une image de l’organe sur lequel le traceur s’est fixé. L’image scintigraphique a une résolution spatiale médiocre (de 2 à 5 mm), mais apporte de précieux renseignements fonctionnels, en particulier lorsqu’on réalise des successions d’images qui renseignent sur la cinétique du traceur (scintigraphie dynamique). Les traceurs actuellement utilisés sont le technétium (99 mTc), combiné à diverses molécules qui orientent sa fixation (gluconates, pyrophosphates, colloïdes, globules rouges fragilisés, etc.). L’iode 131, le xénon 133, le gallium 67 ont des indications particulières (cf. médecine NUCLÉAIRE).Les applications de la scintigraphie demeurent nombreuses et ses principales indications sont, pour le cerveau: tumeurs, débit sanguin, troubles du transit du liquide céphalo-rachidien; pour le squelette: métastases, infections, certaines tumeurs; pour la thyroïde: nodules et kystes; pour les poumons: perfusion, ventilation; pour les surrénales: tumeurs et hyperplasies; pour le foie et la rate: tumeurs, hématomes; pour les reins: fonction rénale.Échographie et Doppler: le stéthoscope de demain?Sans danger, indolore, peu coûteux, l’emploi des ultrasons a connu une expansion fantastique depuis les premiers essais des années 1960. Aucune femme enceinte n’y échappe. L’échographie donne d’excellentes images du foie, de la rate, des reins, de la thyroïde, de la prostate et des organes génitaux. Pourtant, le tube digestif, le poumon et l’os ne peuvent être explorés, en raison surtout des lois physiques de formation auxquelles obéit ce type d’image. Les ondes ultrasonores ont une fréquence élevée: de 3 à 10 MHz en échographie médicale (le son est limité à 25-30 kHz). Elles se propagent aisément dans les liquides ou dans les demi-solides constitués par les parenchymes. Toute discontinuité tissulaire provoque un écho partiel que l’on peut localiser dans l’organe exploré par son temps de retour à la «sonde» émettrice et réceptrice. Le principe est le même que celui de l’évaluation de distance d’une montagne «échogène» par mesure du temps de retour de l’écho (la vitesse du son dans l’air, comme dans les tissus, est connue).Si l’on représente alors chaque écho par un point sur la ligne correspondant à la direction de l’émission, il suffit d’émettre selon des directions multiples pour reconstituer les contours et la structure de l’organe exploré. Les échographes actuels donnent en temps réel des images obtenues par sonde rotative (lignes divergentes) ou à partir de barrettes faites de cristaux multiples juxtaposés. On voit aujourd’hui les organes, leurs mouvements, leurs battements au moyen d’appareils très faciles à manipuler puisqu’il suffit de poser sur le ventre, le cou ou les membres une plaquette ou un petit cylindre que l’on peut déplacer et orienter à sa guise. La définition de l’image augmente avec la fréquence, mais l’atténuation du faisceau est très rapide pour les fréquences supérieures à 5 MHz.La limite de ce merveilleux outil apparaît lorsque le faisceau d’ultrasons se réfléchit en totalité sur le squelette ou les gaz (air pulmonaire, gaz intestinaux), ce qui explique qu’il soit impossible d’explorer le crâne de l’adulte ou les poumons. L’autre limite est liée à l’interprétation des coupes obliques ou de secteurs complexes, où une parfaite connaissance de l’anatomie est indispensable (fig. 2).On définit classiquement deux modes d’échographie: le mode A, qui représente les pics des échos sur la ligne d’émission et donne la distance des structures, et le mode B, qui transpose ces pics en points d’intensité lumineuse proportionnelle et utilise de multiples lignes pour reconstruire directement la morphologie. L’échographie temps-mouvement (T.M.) visualise les variations des échos de structures cardiaques (valves, parois) au cours du cycle. D’autres modes ont été proposés (holographie ultrasonore, images de transmission), mais le mode B est le plus employé, et ses applications médicales sont très étendues.Il existait en 1985 quatre mille échographes en France, employés surtout par les obstétriciens (50 p. 100) et les radiologues (30 p. 100). Cardiologues, gastro-entérologues, médecins généralistes et spécialistes divers se partagent les 20 p. 100 restants. Une forte tendance se développe en faveur d’un accès de tous les médecins à cette technologie: échographes per-opératoires des chirurgiens, échographes endoscopiques des gastro-entérologues, échographes cardio-vasculaires de plus en plus perfectionnés. Les spécialistes de l’imagerie sont aujourd’hui divisés sur cette prolifération. Deux attitudes se distinguent: les uns souhaitent restreindre à des spécialistes très entraînés une technique d’interprétation souvent délicate et qui nécessite un bon apprentissage; les autres voient dans ces appareils d’emploi simple un «stéthoscope ultrasonore» que tout médecin devrait employer au cours d’un examen médical, quitte à s’adresser à un spécialiste de l’imagerie si une difficulté d’interprétation survient. Attitude logique et moderne, mais qui impliquerait un non-remboursement de ces actes de consultation et l’inclusion dans les études médicales de l’apprentissage indispensable.Voici quelles sont les principales applications médicales de l’échographie B:– crâne-cerveau: uniquement chez l’enfant, à travers les fontanelles; le faisceau ne traverse pas le crâne chez l’adulte;– cou: thyroïde, parathyroïde, vaisseaux du cou;– thorax: surtout le cœur, l’air pulmonaire masquant les autres structures;– pelvis: utérus, ovaires, testicules, prostate, vessie; surveillance obstétricale;– membres: tendons, hématomes, vaisseaux;– sein: recherche de kystes ou de certaines tumeurs.L’échographie Doppler apporte un complément très efficace à l’imagerie en évaluant les flux vasculaires. Chacun sait que le son émis par un objet en mouvement (sifflement d’un train par exemple) devient de plus en plus aigu lorsqu’il se rapproche et de plus en plus grave lorsqu’il s’éloigne. Le changement de fréquence des ultrasons réfléchis par des globules sanguins en mouvement permet d’évaluer leur vitesse. Des progrès très spectaculaires permettent aujourd’hui de superposer à l’image échographique d’un vaisseau une représentation colorée des vitesses qui autorise la détection directe sur l’image des sténoses (rétrécissements) ou des thromboses (occlusions vasculaires).Les risques de l’exploration ultrasonore ont été très étudiés, en raison de la diffusion de la méthode. Des faisceaux d’ultrasons de haute puissance (plus de 1 W/cm2) entraînent une altération permanente des tissus traversés. Les puissances moyennes utilisées en diagnostic médical sont de 20 milliwatts, et ce sans aucune conséquence tissulaire.Imagerie par résonance magnétique (I.R.M.)Immédiatement après la découverte de Bloch et Purcell, la résonance magnétique nucléaire (R.M.N.) devint un instrument privilégié en chimie organique. Elle donnait des renseignements inégalables sur la structure des molécules, les liaisons chimiques ou le taux de réaction des substances examinées. Un an à peine après la découverte, Bloch tenta une application biologique: en 1948, il introduisit un doigt dans la bobine de son spectromètre et reçut un signal R.M.N. Il restait à coder le signal dans l’espace pour en faire une image. Un Français, Gabillard, faillit trouver la solution en 1950, mais abandonna son approche. C’est en fait en 1969 que l’idée vint à un professeur de la faculté de médecine de New York, Damadian, de tenter de voir le cancer par imagerie R.M.N. Le premier, il comprit que la localisation spatiale était le concept crucial et il proposa une solution de balayage peu efficace mais possible dans une série d’articles publiés en 1971 par la revue Science . Dès cette date, avec une étonnante prescience, Damadian écrivait: «De tels détecteurs constitueront un équipement standard dans les hôpitaux et les cliniques.» Ce concept révolutionnaire, proposé par un intrus, un médecin, fut rejeté avec violence par le milieu de la chimie physique. On montre encore dans certains laboratoires la lettre d’un «expert» du C.N.R.S. qui affirmait en 1972 l’impossibilité de ce type d’imagerie. On relit avec étonnement les déclarations de savants professeurs jurant que la R.M.N. parviendrait tout juste à montrer les pépins d’un grain de raisin. Cependant, à travers d’incroyables difficultés, Damadian entreprenait la réalisation d’un aimant supraconducteur qui devait aboutir en 1977 aux premières images du thorax humain. Certes, dès 1976, des physiciens à l’esprit plus ouvert avaient obtenu des images de petits objets. Lauterbur avait défini la méthode de localisation par «gradients» de champ. Mansfield mit au point en Angleterre un intéressant procédé d’excitation sélective. Il n’en reste pas moins que l’idée initiale et la première application pratique sont venues de Damadian, médecin devenu physicien par force.Les principes de l’imagerie par résonance magnétique sont fondés sur les propriétés de certains noyaux atomiques de spin non nul que l’on peut assimiler à de petits aimants (dipôles). L’hydrogène H, le sodium 23 Na, le phosphore 31P sont, parmi beaucoup d’autres, des atomes utilisables. Depuis 1987, l’I.R.M. est surtout basée sur le proton, noyau d’hydrogène très abondant dans le corps humain.La création du «signal R.M.N.» se fait en deux temps. Le corps examiné est d’abord placé dans un puissant champ magnétique (de 5 000 à 20 000 gauss) qui aligne les protons dans l’axe du champ. Un deuxième champ magnétique oscillant à une certaine fréquence perturbe l’équilibre et déclenche une bascule des axes de rotation des noyaux. Lorsque l’excitation cesse, le système ainsi perturbé revient à l’état initial et réémet un signal (restitution d’énergie) pendant le temps du retour à l’équilibre (temps de relaxation). Des codages spatiaux utilisant des gradients de champ magnétique permettent de mesurer le signal point par point et de reconstruire l’image d’une coupe.L’imagerie par résonance magnétique dépend de paramètres multiples, ce qui fait sa valeur pour tenter de «caractériser» les tissus examinés: la densité de protons, les «temps de relaxation» qui dépendent de la structure chimique moléculaire, les flux sanguins ou capillaires et d’autres facteurs interviennent. L’examen apparaît sans danger, sauf pour les porteurs de pacemaker, de prothèses métalliques ou de clips ou les malades ayant des inclusions métalliques (éclats), tous ces éléments risquant d’être modifiés ou déplacés par le champ magnétique.Les résultats de l’I.R.M. sont remarquables (fig. 3). Le contraste des tissus dépasse celui des meilleurs scanners X, et tous les plans de coupe sont possibles (le scanner n’autorise que des coupes horizontales, dites axiales ou transversales). Le tableau 1 résume les principales indications possibles. Les limites de la méthode apparaissent dans l’étude des organes mobiles (thorax ou abdomen), car le temps d’acquisition d’une image est encore de quelques minutes. La méthode progresse vite, et devrait, d’ici à quelques années, remplacer un grand nombre des indications du scanner X et de l’échographie. Les meilleures applications actuelles demeurent cependant le cerveau et la moelle épinière, d’une part, les os et les articulations, d’autre part, régions qu’il est facile d’immobiliser complètement.Les contraintes sont surtout financières (une dizaine de millions de francs à l’achat, avec un prix de revient de 3 000 francs par examen), mais aussi techniques: appareils lourds (de 10 à 90 t) et champ magnétique étendu à plusieurs mètres de l’appareil, ce qui perturbe les appareils électroniques et les enregistreurs magnétiques.Radiologie interventionnelleL’explosion récente de l’imagerie a transformé la médecine. Elle fait aussi évoluer les radiologistes vers des comportements plus actifs, dans leurs diagnostics et leurs thérapeutiques.La radiologie interventionnelle diagnostique ponctionne abcès ou tumeurs sous guidage par ultrasons ou scanner X. Très souvent, il n’est plus nécessaire d’avoir recours à la laparotomie exploratrice (ouverture de l’abdomen) pour rechercher la lésion. Les aiguilles inframillimétriques employées sont inoffensives.La radiologie interventionnelle thérapeutique a trois orientations principales: l’embolisation des malformations vasculaires ou des pédicules tumoraux, la dilatation des vaisseaux ou des canaux rétrécis, et l’aspiration-drainage des abcès, hématomes ou épanchements de l’abdomen et du thorax.Tous ces actes sont peu ou ne sont pas traumatisants; ils ne nécessitent qu’une très courte hospitalisation et évitent au malade une chirurgie souvent complexe. Mieux vaut un scanner qu’une cicatrice (fig. 4).Lecture et interprétation: le radiodiagnosticRien ne s’oppose en théorie à ce qu’un jour l’œil du robot soit capable de lire et d’interpréter en expert, parfois, l’image médicale. Le savoir est de plus en plus «informatisé» et divisé, mais il est peu probable que la synthèse des maux dont souffre un homme puisse être faite par la machine. Le maître mot de l’imagerie demeure en effet son «interprétation», autour de laquelle gravitent les connaissances du «lecteur» aussi bien que les hypothèses particulières issues du patient examiné (Pl. II, L’interprétation).La réflexion clinique relie les symptômes, et doit compter avec une problématique de l’intégral, quitte à gommer abusivement parfois les particularismes. À l’objectivité excessive d’une lecture automatique risque ainsi de s’opposer, dans certains cas, une interprétation orientée.L’imagerie nouvelle aggrave encore la difficulté: depuis une dizaine d’années, les différences d’opacité (du noir au transparent) sont codées sur 500 à 4 000 niveaux de «gris» (de 9 à 12 bits) alors que l’œil ne peut observer avec un bon contraste que de 60 à 100 niveaux (de 6 à 7 bits). On ne peut plus parler d’une image de scanner ou d’I.R.M., mais d’une pile de structures qu’il faut explorer l’une après l’autre au moyen d’une fenêtre acceptable. On parle constamment en scanographie de «fenêtre os», de «fenêtre pulmonaire», etc., correspondant chacune à un réglage différent de la console de visualisation (fig. 5).Prenons un exemple simple: un homme de cinquante ans a mal au dos. La radiographie conventionnelle réalisée sur un film de dynamique limitée (100 niveaux de gris) ne montre que le squelette mais peut être «lue» devant une quelconque source lumineuse: négatoscope médical, lampe, voire lumière du jour. Le scanner de la vertèbre douloureuse doit être lu sur la console avec plusieurs fenêtrages. Un examen en fenêtre «tissus mous» peut montrer l’absence de hernie discale et effacer l’image d’une métastase cancéreuse qu’aurait révélée un fenêtrage différent.Ainsi, à la pléthore des images, s’ajoute leur extrême complexité. La nouvelle imagerie doit renoncer aujourd’hui à restituer le contenu réel d’un examen. La complexité dynamique de l’image ne serait compatible qu’avec un disque magnétique ou optique que chaque médecin pourrait consulter sur sa console. Mais que de temps perdu. L’«extrait interprété», sur un film ou un papier, suffit, si l’interprète est bon. Mais se trouve remis en question, dans cette perspective, le postulat qui veut que soit disponible l’intégralité des informations obtenues.Problèmes d’utilisationAccepter l’imagerie moderneL’imagerie médicale fait peur lorsqu’on la connaît mal. Elle emploie des appareils onéreux, mais sa part dans les dépenses de santé augmente moins vite que le coût du personnel paramédical: les dépenses actuellement liées à l’imagerie en France ne représentent que 5 p. 100 du total des dépenses de santé. Surtout, c’est à l’intérieur du budget de l’imagerie que de nouveaux équilibres apparaissent. Contrairement à ce que pensent des augures mal informés (fig. 6), l’addition des examens n’a lieu que pendant une courte période d’évaluation comparative. Scanner X et échographie ont pratiquement éliminé le recours à l’angiographie, plus dangereuse: entre 1975 et 1985, les examens vasculaires ont chuté de 36 p. 100 en R.F.A. et de 55 p. 100 en France. L’endoscopie a littéralement tué l’exploration digestive à base de bouillie barytée, au point qu’il est difficile dans certains hôpitaux d’en apprendre la technique aux étudiants. Scanner et I.R.M. ont considérablement diminué la myélographie, opacification pénible des enveloppes de la moelle; l’encéphalographie gazeuse (pour voir les ventricules cérébraux) et l’arthrographie du genou sont menacées. D’innombrables études de rapports coûts/bénéfices ont prouvé quel était l’intérêt économique d’un emploi judicieux de la «nouvelle imagerie». Prenons deux exemples bien connus aujourd’hui: de 1975 à 1985, le coût du diagnostic et du traitement d’un ictère (jaunisse) a diminué de 77 p. 100. Durant la même période, le coût du diagnostic d’une sciatique grave a diminué de 60 p. 100. Plus encore, l’imagerie moderne a largement contribué à la réduction de la durée moyenne de séjour, passée de près de 20 jours à 5 grâce aux nouveaux moyens de diagnostic. Personne n’accepterait le retour à cette époque où le diagnostic d’une lésion abdominale était fait par ouverture du ventre, ce que l’on appelait la laparotomie exploratrice, intervention lourde et non dépourvue de complications.Aux États-Unis, l’angioplastie (dilatation des artères) revient à 4 700 dollars, contre 15 000 pour le classique pontage. En R.F.A., la diffusion de la lithotriptie (destruction des calculs), guidée par l’indispensable imagerie, permet d’épargner 140 millions de deutsche Mark par an (près de 500 millions de francs) et rembourse très largement l’investissement. On pourrait multiplier à l’infini ces exemples.Malgré de tels avantages, pour quelles raisons subsiste-t-il un courant de rejet ou de refus de l’imagerie dans le corps médical? Certes, la radiologie semble opulente et elle consomme une bonne part des chiches crédits d’équipement: la simple maintenance de certains scanner X coûte plus d’un million de francs par an. Mais ces analyses sont démenties par les économies réalisées et par la mutation médicale qu’induisent ces appareils. Faut-il alors voir là une crainte plus ou moins consciente d’une évolution faustienne où la machine déshumaniserait la médecine? C’est possible, mais très irrationnel. Tout appareil – fibroscope, scanner ou caméra scintigraphique – est une extension de la vue; il permet de voir l’intérieur du patient. Pourquoi le fait de mieux percevoir la lésion cherchée aboutirait-il à une médecine inhumaine? Que l’on palpe un abdomen ou que l’on regarde une coupe, la qualité de l’acte médical ne peut changer et elle sera toujours le reflet de la qualité du médecin. Simplement, on n’examine plus un pancréas ou un rein en 1987 comme en 1970 (fig. 6).Il reste toutefois un frein éducatif. Les progrès ont été si rapides que beaucoup de médecins sont restés sur la rive. La prescription des nouveaux examens doit suivre des règles rigoureuses qu’il faut apprendre. Or l’enseignement de l’imagerie est absent des programmes de la plupart des facultés: on découvre encore dans les «questions d’internat» des listes absurdes d’«examens complémentaires» que l’on retrouvera sur les fiches de prescription établies par les jeunes médecins. Un effort pédagogique important demeure donc nécessaire.Devenue indispensable, l’imagerie médicale fait peur lorsqu’on la connaît mal. Elle accroît pourtant la probabilité du résultat de l’acte médical et réduit la durée de l’hospitalisation. Elle est un des grands progrès qui ont permis la mutation de la médecine actuelle.Difficultés socio-économiquesEn 1988, 4 358 radiologistes utilisent en France 25 000 tables d’examen, près de 400 scanners X, 53 I.R.M. et un nombre inconnu d’échographes. Deux actes radiologiques par habitant (100 millions) sont réalisés chaque année, et représentent une valeur de plus de 10 milliards de francs. La croissance rapide (9 p. 100 par an) observée jusqu’en 1980 s’est ralentie pour les radiographies conventionnelles, mais demeure forte pour l’échographie et le scanner X. Dans son ensemble, l’activité radiologique française reste dans la moyenne des pays industrialisés.De nombreux non-radiologistes réalisent des examens d’imagerie (cardiologues, gastro-entérologues, pneumologues). Les radiologistes, qui gardent 70 p. 100 de l’activité en ce domaine, sont tentés par une surspécialisation, probablement inévitable. Il existe ainsi des neuro-radiologues et des radio-pédiatres, mais aussi des échographistes, des scanographistes, ou même des spécialistes de la radiologie interventionnelle touchant à la chirurgie. Il n’est pas certain que l’unité de la discipline survive à ces tendances centrifuges.La construction du matériel biomédical d’imagerie est devenue une entreprise coûteuse, tributaire aussi de très importantes dépenses de recherche. En 1988, le marché mondial représentait 6 000 millions de dollars (États-Unis, 50 p. 100; Europe, 24 p. 100). Le marché français ne dépasse pas 4,5 p. 100 de cet ensemble, soit 1 900 millions de francs environ. Il est cependant en évolution rapide: certes, la radiologie conventionnelle y représente encore 50 p. 100, mais elle stagne. Le scanner représente, en francs, 13 p. 100 des achats (croissance: 5 p. 100 par an), l’échographie 20 p. 100 (croissance: 16 p. 100 par an) et l’I.R.M. 15 p. 100 (avec une croissance de 20 p. 100 par an). Les alliances industrielles de 1987 ne laissent en place que quatre groupes géants: General Electric + C.G.R. (25 p. 100 du marché mondial), Philips (15 p. 100), Siemens (19 p. 100), Toshiba (9 p. 100). Une pléiade de plus petites industries ou de fabricants d’accessoires complète ce tableau.Réglementation de l’imagerie médicaleTous les pays, même les plus avancés, éprouvent des difficultés d’acquisition et de développement vis-à-vis des nouvelles technologies. Après une phase de réglementation assez stricte, l’implantation de scanners X et d’I.R.M. est pratiquement libre aux États-Unis, certains examens I.R.M. n’étant cependant pas remboursés par les assurances. Le frein est puissant en Angleterre, mais contrôlé en grande partie par le corps médical. Le pouvoir administratif est moins strict en France, mais les avis médicaux ne sont pas majoritaires; d’où un risque d’arbitraire et une trop grande soumission aux pressions politiques.Scanners X, I.R.M. et caméras de scintigraphie sont inscrits sur la liste des «équipements lourds» prévus par l’article 46 de la loi du 31 décembre 1970. Les «indices de besoins» sont liés à la «carte sanitaire» et doivent assurer une répartition harmonieuse des appareils. Pour le scanner X, l’indice est passé de 1 pour 1 000 000 d’habitants en 1976 à 1 pour 140 000 à 250 000 habitants en 1987. L’indice 1987 de l’I.R.M. est de 1 pour 600 000 à 1 600 000 habitants, celui des caméras de scintillation de 1 pour 150 000. L’effet de freinage a joué, en particulier pour le scanner X, mais la pression médicale s’est faite si forte dans les années 1980 que la position de l’administration est vite devenue intenable. C’est, en effet, aux possibilités de diagnostic rapide et non invasif du scanner X que sont dues, en grande partie, la réduction des durées d’hospitalisation observée de 1975 à 1985 et la modification du cours et du traitement de nombreuses affections.En 1989, l’examen au scanner est devenu courant, applicable «de la tête aux pieds» à de très nombreuses pathologies, un examen radiologique comme les autres, avec un coût d’investissement en baisse; il n’existe plus de raisons pour réglementer son emploi. Ce n’est plus tant le scanner que l’administration cherche à contrôler, mais la radiologie. À cette pression aveugle d’une contrainte quantitative (rationnement de l’offre), il convient de substituer au plus vite le contrôle qualitatif lié à la logique médicale (rationalisation de la prescription) qui peut, lui, s’appuyer sur un consensus scientifiquement établi.Risque et radioprotectionLe risque de radiations en matière d’imagerie médicale existe. On l’exagère souvent, on le néglige parfois, mais nul ne peut le nier. Les accidents aigus sont devenus rarissimes avec les appareils modernes. Les risques réels sont statistiques, proportionnels à la dose et peuvent être classés selon deux groupes: les risques somatiques, qui concernent tous les organes, mais particulièrement les organes «sensibles» (tabl. 2); les risques génétiques, qui sont d’évaluation difficile. Si l’on admet que la dose de 30 rads (0,3 Gy) sur les gonades double la fréquence spontanée des mutations, le taux d’anomalies génétiques s’est néanmoins révélé très faible chez les descendants des survivants des bombardements atomiques. La plupart des mutations graves sont létales et n’apparaissent pas dans la population. Pour un fœtus ou un embryon, on admet que la dose critique est située entre 5 et 10 rads.L’irradiation des patients est un sujet de préoccupation important depuis quelques années en raison de la croissance du radiodiagnostic, dont l’activité double tous les dix ans. L’irradiation médicale est devenue une des principales sources de rayonnements ionisants atteignant les gonades, dont le tableau 2 donne les valeurs moyennes.La dosimétrie de la radiographie pulmonaire offre des difficultés particulières en raison de la fréquence de cet examen, très largement exécuté lors des examens systématiques. Le meilleur moyen d’examiner le thorax est le cliché simple de face, grand format, qui délivre une dose modérée (de 50 à 100 mrem) encore abaissée par l’emploi d’écrans haute sensibilité (de 10 à 20 mrem). Ces valeurs s’opposent aux 800 millirems nécessaires en radiophotographie 10 憐 10 cm (camions de dépistage) et surtout aux 3 000 millirems d’une minute de radioscopie pulmonaire «conventionnelle». Lorsqu’il est encore nécessaire (travailleurs immigrés, mineurs, personnel hospitalier, fumeurs), l’examen systématique devrait être pratiqué en «grand format et écrans sensibles». De la même manière, une autre solution que l’emploi des rayons X devra être recherchée pour le dépistage de la luxation de la hanche, source d’irradiation importante des gonades et de la moelle osseuse chez le très jeune enfant. Enfin, la sensibilité du fœtus à l’irradiation doit faire proscrire chez la femme enceinte tout examen inutile, et choisir pour les radiographies indispensables les techniques les moins irradiantes.La radioprotection pratique est réglementée par l’arrêté d’avril 1962, le décret du 15 mars 1967, l’arrêté du 23 mai 1977 (qui concerne essentiellement la protection de la femme enceinte) et celui du 10 octobre 1977, qui introduit la notion de radioprotection du patient.Il convient, en conclusion, de souligner le fait que le bilan bénéfice/risque des examens radiologiques est largement positif. La plupart des examens prescrits et des clichés réalisés sont indispensables. La radiologie influence l’orientation diagnostique du clinicien dans la majorité des cas et on ne saurait parler d’abus des rayons X. Le développement de l’activité radiologique impose pourtant une certaine vigilance, la révision de certains protocoles «de routine», une réflexion sur la hiérarchie des examens d’imagerie et l’orientation des premières séquences vers l’emploi des ultrasons. Enfin, l’éducation technique de tous les utilisateurs de rayons X, y compris des non-radiologistes, est devenue une nécessité.Quel avenir?On ne peut encore affirmer que les techniques d’imagerie en coupe employant les rayons X ou la R.M.N. donnent des informations équivalentes à la coupe histologique. Le problème de la «caractérisation tissulaire» reste posé. Sa solution est la réponse que tous attendent à la question: cancer ou non?Mais la science ne peut résoudre des problèmes que si les acteurs du combat médical posent les bonnes questions. Dans l’ensemble, les systèmes d’imagerie proposés par les constructeurs ou les physiciens sans besoin médical exprimé sont des échecs. Que l’on songe par exemple à la thermographie dérivée des matériels militaires, et d’intérêt médical quasi nul, ou à certaines applications des ultrasons (balayage automatique en cuve) qu’un constructeur a tenté d’imposer sans succès.Hommage aux audacieux médecins qui surent, comme Ambrose ou Damadian, poser le vrai problème. Hommage aux esprits ouverts des physiciens qui, tels Hounsfield ou Lauterbur, parvinrent à comprendre ce que voulaient les médecins, en dépit des difficultés évidentes de la communication entre scientifiques de formation différente.En présence d’un besoin technologique médical, il est probable que l’ingénieur détient la solution. Encore faut-il que se rencontrent les protagonistes. La force de l’Université anglaise est de savoir organiser ces déjeuners informels, ces bavardages autour du thé dont sont sorties la plupart des innovations. On ne peut pas dire que les constructeurs, obsédés par le profit immédiat, aient saisi l’occasion. Ni pour les ultrasons, ni pour le scanner, ni pour l’I.R.M., on ne les vit au premier rang. Leur succès final est celui du commerce, du rouleau compresseur qui lamine la P.M.E. innovatrice en s’appuyant sur l’indispensable réseau commercial.Reste-t-il encore quelque espoir de voir des innovations en imagerie? Certainement oui, si nous savons organiser et stimuler les contacts entre physiciens et médecins, si nous développons les laboratoires universitaires d’imagerie médicale, si les médecins apprennent un peu de physique, et les physiciens des éléments de médecine. Le cloisonnement français devrait prendre exemple sur la souplesse anglaise.Dans ce cadre élargi, la confiance entre médecins et ingénieurs doit être un élément essentiel, même s’il lui faut parfois les béquilles que sont contrats et conventions. Le physicien doit accepter d’associer à sa découverte le médecin donneur d’idées. Le médecin doit se former à la rigueur méthodologique qui lui permettra d’appliquer à la «recherche clinique» nouveaux produits ou appareils expérimentaux. C’est grâce à une véritable «task-force» constituée autour du site médico-industriel de Buc que l’imagerie I.R.M. française a été mise au point entre 1983 et 1985, dans un temps record.Peut-on, pour conclure, suggérer quelques directions? Les imageries micro-ondes paraissent dans l’impasse. L’exploitation complète de l’interaction entre ultrasons et tissus progresse lentement, les cartographies électriques, cérébrales ou cardiaques, sont perfectibles, mais l’imagerie de marqueurs immunologiques à fixation spécifique ou de traceurs nouveaux peut apporter la réponse tant attendue à la caractérisation d’un tissu. La R.M.N. est-elle la «dernière fenêtre» de l’imagerie? Certains le pensent. Seul l’avenir pourra en décider. Quiconque prédit l’avenir technologique est assuré de se tromper. Cet avenir dépend très directement de la créativité et de l’innovation. Il ne peut que surprendre.
Encyclopédie Universelle. 2012.
